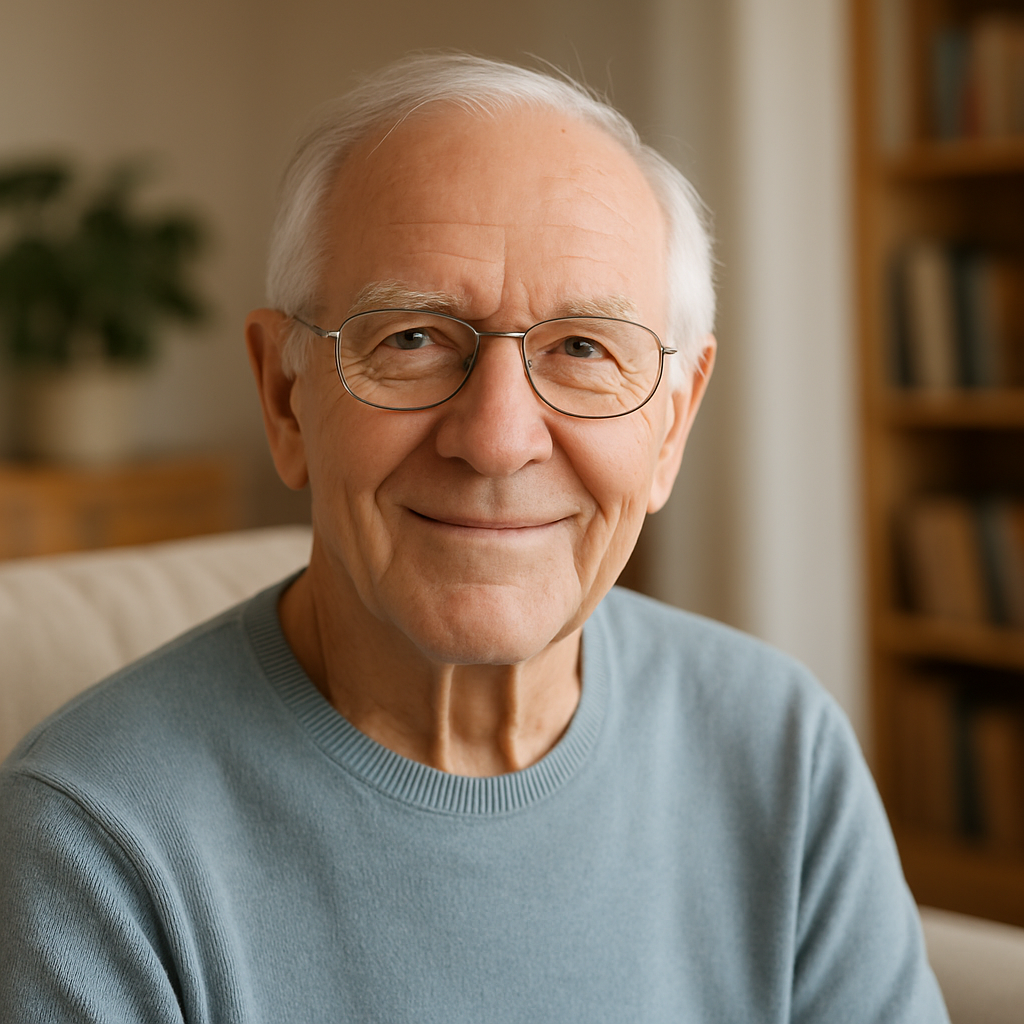Je suis à la recherche :

D'une aide à domicile

D'un emploi
Mes informations :

APA ou PCH : quelle aide choisir pour le maintien à domicile en Île-de-France ?
Comparatif APA vs PCH : pour qui, montants, aides couvertes, choix après 60 ans et démarches. Guide clair par Auxicare (Île-de-France).

APA ou PCH : comment choisir la bonne aide ?
Lorsque l’on accompagne une personne âgée ou en situation de handicap, il est essentiel de connaître les aides disponibles. Deux prestations phares existent en France : la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie). Bien qu’elles partagent un objectif commun, celui de compenser la perte d’autonomie; elles répondent à des réalités différentes. Voici un comparatif complet réalisé par Auxicare pour vous aider à comprendre les démarches.
APA vs PCH : les différences essentielles en un tableau
.png)
La PCH est conçue pour les personnes qui vivent avec un handicap reconnu, peu importe leur âge, tant que celui-ci est antérieur à 60 ans. À l’inverse, l’APA concerne toute personne âgée de plus de 60 ans en perte d’autonomie. Elle permet notamment de financer une aide à domicile, y compris pour les gestes du quotidien. Ce tableau aide à identifier à qui s’adresse chaque dispositif.
Cumul impossible, mais un choix à faire :
La non-cumulabilité entre les deux aides est un point central de la politique d’autonomie mise en place en France autant au niveau national que local. Toutefois, la souplesse du système permet d’exercer un droit d’option : une personne bénéficiant de la PCH peut, après 60 ans, passer à l’APA si cela correspond mieux à ses besoins, et inversement. Ce droit est particulièrement utile en cas de passage à la retraite ou de changement dans les conditions de vie.
Conditions d’attribution
.png)
L’attribution de l’APA repose sur la grille AGGIR, un outil officiel d’évaluation de la perte d’autonomie. Une personne est éligible si elle est classée GIR 1 à 4. Pour la PCH, il s’agit d’évaluer les conséquences du handicap. Dans les deux cas, la résidence stable en France est indispensable, mais le niveau de ressources influence la part prise en charge, pas l’accès à l’aide.
Que financent la PCH et l’APA ?

La PCH est centrée sur la compensation du handicap : aide humaine, fauteuil roulant, transport, voire animal d’assistance. En revanche, l’APA propose une prise en charge plus globale, adaptée aux besoins de la personne âgée à domicile ou en établissement. Elle peut intégrer le portage de repas, le ménage, ou encore la téléassistance, une solution souvent couplée à une mutuelle senior.
Montants et plafonds

La PCH prévoit des plafonds spécifiques (ex : 13 200 € pour aides techniques, 10 000 € pour logement), ce qui permet une gestion fine des besoins. L’APA adopte une approche plus souple mais moins personnalisée : un montant mensuel global est attribué selon le niveau de dépendance. Ce système est plus lisible pour les aidants, mais parfois moins ajusté pour les situations complexes. Ainsi, la PCH fonctionne avec des plafonds par type d’aide, ce qui permet de cibler précisément chaque besoin. En revanche, l’APA fonctionne avec un plafond global mensuel, fixé selon le degré de dépendance (GIR). Dans les deux cas, ces plafonds peuvent limiter le montant pris en charge, et une part des frais peut rester à la charge de la personne, surtout si ses revenus sont élevés.
Aidants familiaux : dédommagement et emploi
.png)
La PCH reconnaît pleinement le rôle de l’aidant familial, qui peut être dédommagé pour son temps d’accompagnement. C’est une avancée majeure pour les familles, surtout lorsque l’aidant a dû cesser ou réduire son activité professionnelle. L’APA, quant à elle, ne prévoit pas de rémunération directe pour les proches aidants, mais permet dans certains cas de les salarier.
Ainsi, quelle aide choisir ?
.png)
Le bon choix dépend de votre parcours de vie. Un adulte handicapé qui vieillit peut conserver la PCH si elle est plus avantageuse. En revanche, une personne de plus de 60 ans qui perd en autonomie sans avoir de handicap reconnu auparavant sera orientée vers l’APA. Cette dernière peut aussi être un complément à d’autres soutiens comme la minimum vieillesse ou une complémentaire santé senior.
Les Conseil Auxicare :
Le choix entre PCH et APA doit se faire avec l’aide d’un professionnel (assistante sociale, MDPH, service autonomie du département), car chaque cas est unique. N’hésitez pas à demander une évaluation gratuite de votre situation.

.jpg)
.jpeg)
%20(1).png)